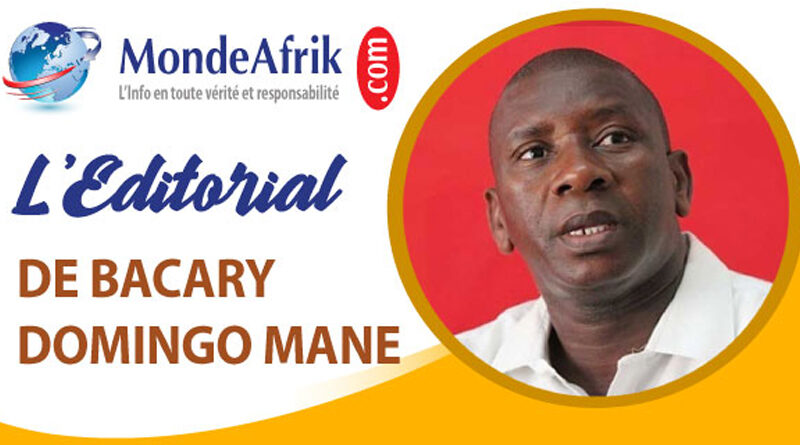EDITO -Dialogue national : Quel sort réserver à l’ECOUTE !
Par Bacary Domingo MANE
De nombreux partis politiques et coalitions, de même que des organisations de la société civile, à l’exception de quelques politiciens, ont affiché leur volonté de prendre part au dialogue national sur le système politique sénégalais, initié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
Certains prendront la parole en s’exprimant en toute sincérité, d’autres feront dans la langue de bois en servant un discours creux, sans consistance, juste pour mettre leur personne en avant. Les plus pressés l’arracheront, en faisant leur show, transformant la parole en instrument au service d’un agenda caché.
Les premiers cités ont une idée claire de la vertu du dialogue, les suivants ne sont pas conscients des enjeux et les derniers sont des égoïstes, incapables de servir la République ou autrui, car tout tourne autour de leur petite personne. C’est l’idée que soutient Schopenhauer qui distingue les esprits superficiels des esprits profonds. Les premiers, dit-il, parlent sans écouter, cherchant à imposer leur point de vue et les seconds savent écouter, car ils comprennent que le savoir se construit dans l’échange et la réflexion.
Si l’on reste dans ce schéma que nous avons décrit, il est fort à craindre que l’Ecoute ne s’invitera pas à la table du dialogue. Et dans ce cas, ce dernier se transformera en monologue.
L’Ecoute est le ciment d’un dialogue constructif : c’est un acte de respect et de considération envers l’autre. Cette voix discrète est synonyme d’humilité et d’ouverture sur un monde de plus en plus complexe. Ceux qui tenteront de la réduire à une simple attente du tour de parole, ne connaitront pas la vraie valeur du silence.
Dans l’effervescence du débat, où les voix s’élèveront et les arguments s’entrechoqueront, il serait plus que nécessaire pour les acteurs de privilégier l’écoute active, celle qui ne juge pas, ne catégorise pas et n’humilie pas. Elle est plutôt synonyme d’un engagement profond, une posture où la pensée de l’autre trouve un véritable espace d’accueil, faisant le lit d’une compréhension authentique. Spinoza ne nous enseigne-t-il pas que comprendre autrui exige de l’écouter sans préjugé, sans passion aveugle. Pour lui, le dialogue n’est possible et fécond que lorsque l’on suspend nos certitudes pour accueillir celles de l’autre.
L’écoute active que nous appelons de tous nos vœux dans ce dialogue, doit être assimilée à un exercice de neutralité bienveillante, où l’on cesse de vouloir convaincre pour simplement comprendre. Elle est loin d’être une soumission, mais une force qui cherche à élargir son horizon plutôt qu’à le refermer sur lui-même.
Elle (l’écoute) n’est pas un silence méprisant mais plutôt inclusif qui crée un lien, transformant le discours en dialogue, l’affrontement en échange, la séparation en rapprochement. Lorsque Hannah Arendt assimile l’écoute à la reconnaissance de l’autre dans son humanité, c’est qu’elle n’ignore pas qu’elle est le fondement de la vie démocratique.
Dans un débat enflammé, le silence de l’écoute est une invitation à la profondeur, une respiration qui donne au sens le temps de se révéler. L’écoute nous apprend à voir l’autre au-delà des apparences, à dépasser le bruit des certitudes pour atteindre l’essence du dialogue. Elle est surtout un acte de courage, demandant une grande capacité à dépasser son égo, renoncer à sa volonté et à s’ouvrir à une vérité qui dépasse l’individu.
Nul doute que la vérité n’émerge pas d’un seul esprit, mais de la confrontation respectueuse des idées. La démocratie qui respire est celle où chaque voix trouve écho, où l’échange nourrit plutôt qu’il ne consume. Une société sans dialogue s’asphyxie, étouffée par l’ombre des monologues imposés.
Le dialogue politique est un concert où chacun chante pour une symphonie riche de ses différences. C’est pour dire avec Arendt que la politique n’est pas qu’une affaire de pouvoir, mais un espace de rencontres, une agora où les récits personnels se croisent pour tisser une histoire commune. C’est en écoutant que l’on donne vie à une démocratie qui inspire et ne suffoque pas sous le poids du mépris.
Un peuple qui débat est un peuple qui grandit, défiant la pensée unique pour embrasser le foisonnement des idées. Dans un pays où les différences sont parfois perçues comme des fissures, le dialogue répare plutôt qu’il ne brise. Une démocratie sans dialogue devient un champ de ruines, où chacun campe sur ses certitudes, incapable de bâtir un pont vers l’autre.
Silence, on s’écoute, le dialogue démarre !
Bacary Domingo MANE (Mondeafrik.com)